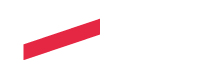- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF
Vous êtes ici :
- Accueil ›
- Actualités du LIRTES
- Recherche,
Séminaire "Penser et agir, entre dispositifs et institutions" 4ème séance
Publié le 13 juin 2012
4ème séance du programme de recherche transversal du REV-CIRCEFT.

Date(s)
le 19 juin 2012
de 16 h à 19h
Lieu(x)
La Pyramide, UPEC UFR SESS, salle 302
80, avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil
> plan d'accès
Métro : Créteil l'Echat (ligne8)
80, avenue du Général de Gaulle
94009 Créteil
> plan d'accès
Métro : Créteil l'Echat (ligne8)
Séance 4/6: Séminaire : "Penser et agir, entre dispositifs et institutions"
Pierrine Robin (REV-CIRCEFT, UPEC) : L'accompagnement de la jeunesse en difficulté. Le point de vue des jeunes sur les dispositifs et les institutions.
Dans cette communication, nous nous attacherons à analyser la notion de dispositif à travers l’exemple des dispositifs spécifiques d’accompagnement à l’âge adulte en difficulté sociales et familiales. L’objectif est de retracer la façon dont ces dispositifs ont été construits et les questions dont ils font aujourd’hui l’objet. Nous nous intéresserons également aux tensions qui traversent leur mise en œuvre entre les rhétoriques professionnelles et les perceptions subjectives par les jeunes proposées.
- Frédérique Elsa Giuliani, (Université de Genève. Laboratoire SATIE) : Pluralité et tensions de l'intervention sociale. Les dispositifs d'accompagnement comme révélateur des recompositions institutionnelles
Au regard des questionnements développés par le REV-CIRCEFT, ce projet de communication vise à alimenter une réflexion sociologique sur les liens articulant dispositifs et institutions en interrogeant l’émergence et le développement de dispositifs dits d’accompagnement dans le travail social. Cette analyse est fondée sur une enquête empirique de type ethnographique conduite par observation concernant un dispositif développé au cœur des Missions Locales Jeunes (TRACE devenu CIVIS) elles-mêmes issues des politiques transversales d’insertion. Ce dispositif préconise « l’accompagnement individualisé des parcours d’insertion » : i.e qu’il prévoit de traiter les problèmes liés à la (non)concrétisation des parcours d’insertion juvéniles, dans le cadre d’une relation soutenue et renforcée entre un conseiller et un jeune. L’objet de cette communication est de proposer une interprétation des relations entre dispositifs (Deleuze, 1989) et institutions dont ce terrain parait exemplaire.
Cheminement et posture épistémologique
La question des prolongements-tensions entre institutions et dispositifs est, à l’origine, au cœur de ma recherche doctorale (2005). Partant des analyses de Jacques Ion relatives au double processus de territorialisation (Ion, 1990) et de singularisation (Ion, 1998) de l’intervention sociale, je me suis intéressée à l’émergence de « dispositifs d’accompagnement » dont le contenu et les pratiques qu’ils recouvrent paraissent difficilement modélisables lorsqu’on s’en tient uniquement à une réflexion sur les métiers du social (Barbe, 2003). Autant, sinon plus, que le savoir-faire, les formations, les métiers, le contexte d’action est déterminant des pratiques professionnelles. Ici, c’est le contexte des dispositifs qui apparaît premier dans la reconfiguration de la relation d’aide et l’instauration d’une relation dite d’ « accompagnement » pour traiter des problèmes relevant aussi bien de l’éducation des enfants que de l’insertion des jeunes. Ma démarche, visant à ouvrir la « boîte noire » des dispositifs d’accompagnement, a consisté en une enquête de type ethnographique conduite par observation. Sans partir d’une définition donnée apriori des pratiques d’accompagnement, j’ai mobilisé les outils de la sociologie interactionniste et pragmatique pour comprendre et décrire « l’ordre endogène » (Quéré, 1987) de ces dispositifs.
Le dispositif comme recomposition de l’action institutionnelle.
Les dispositifs d’accompagnement des parcours d’insertion juvénile (Trace ou Civis) sont des dispositifs au sein de dispositifs : ils prennent forme au cœur d’une première génération de dispositifs, les MLJ, créées à partir des années quatre-vingt pour faire face au développement d’un chômage juvénile de masse. L’action institutionnelle se compose ici d’un « empilement d’ordres anciens et d’ordres nouveaux » (Payet, Laforgue, 2008). Ces dispositifs de seconde génération naissent dans les failles des premiers : les carrières de l’insertion donnent lieu à des situations sociales sans qualités dont les épreuves inédites déroutent l’usager. Dans ce contexte, professionnels et usagers sont sollicités pour trouver dans le cadre d’une relation dite d’accompagnement, les ressources pour agir et s’orienter dans l’espace hostile des procédures d’insertion.
-La relation d’accompagnement constitue la pierre angulaire de ces dispositifs : le face-à-face est pensé comme le lieu pertinent de prise en compte et de traitement de situations problématiques.
-Mais cette relation d’accompagnement n’est pas régulée institutionnellement : professionnels et usagers se règlent sur la base d’accords élaborés dans un rapport de gré à gré qui font figure de pactes (Giuliani, 2008).
-L’action du dispositif d’accompagnement est régulée a posteriori par des procédures dites d’évaluation qui se focalisent uniquement sur les entrées et sorties du dispositif (les flux d’usagers). Telle que pratiquée, l’évaluation accroit le fossé entre les professionnels du front, chargés d’être « au contact » des populations dans le cadre du dispositif et les professionnels du social de gestion (Chauvière, 2007 )
Gilles Monceau (EMA, université de Cergy-Pontoise) : Construire des dispositifs socio-cliniques pour analyser des processus institutionnels
L’histoire de l’Analyse institutionnelle agence dispositifs et institutions depuis les débuts de la « psychothérapie collective » devenue « institutionnelle » dans les années 1950.
Les dispositifs y étaient d’abord thérapeutiques (en psychothérapie) et éducatifs (en pédagogie) avant de devenir plus strictement analytiques (socianalyse). Ainsi, les expérimentations et publications de F. Tosquelles, L. Bonnafé, et Jean Oury ont inspiré et croisé celles de F. Oury, R. Fonvielle et M . Lobrot mais aussi de G. Lapassade et R. Lourau. C'est en continuité avec cette histoire que ces deux derniers ont posé les bases de l’intervention socio-analytique à la fin des années 1960. La finalité analytique a alors pris résolument le pas sur les objectifs thérapeutiques et éducatifs.
Dans cette mouvance théorique et méthodologique, les dispositifs sont construits pour analyser et transformer (à des échelles très variables) les institutions. Ils sont définis comme des "structures-actions" (Lourau) agençant temps et espace en combinant stabilité et dynamique. C'est le cas du Conseil en pédagogie institutionnelle comme de l'Assemblée générale socianalytique. Des connaissances sont collectivement produites et transforment la situation sociale vécue par les sujets.
Le dispositif s'insère donc plus ou moins durablement au sein d'une entité sociale dans laquelle il permet l'analyse des phénomènes institutionnels. Aujourd'hui, les dispositifs socio-cliniques mis en œuvre dans les recherches menées sur les pratiques de la parentalité donnent, par exemple, accès à la manière dont l'action publique transforme le rapport entre parents et institutions.
Pierrine Robin (REV-CIRCEFT, UPEC) : L'accompagnement de la jeunesse en difficulté. Le point de vue des jeunes sur les dispositifs et les institutions.
Dans cette communication, nous nous attacherons à analyser la notion de dispositif à travers l’exemple des dispositifs spécifiques d’accompagnement à l’âge adulte en difficulté sociales et familiales. L’objectif est de retracer la façon dont ces dispositifs ont été construits et les questions dont ils font aujourd’hui l’objet. Nous nous intéresserons également aux tensions qui traversent leur mise en œuvre entre les rhétoriques professionnelles et les perceptions subjectives par les jeunes proposées.
- Frédérique Elsa Giuliani, (Université de Genève. Laboratoire SATIE) : Pluralité et tensions de l'intervention sociale. Les dispositifs d'accompagnement comme révélateur des recompositions institutionnelles
Au regard des questionnements développés par le REV-CIRCEFT, ce projet de communication vise à alimenter une réflexion sociologique sur les liens articulant dispositifs et institutions en interrogeant l’émergence et le développement de dispositifs dits d’accompagnement dans le travail social. Cette analyse est fondée sur une enquête empirique de type ethnographique conduite par observation concernant un dispositif développé au cœur des Missions Locales Jeunes (TRACE devenu CIVIS) elles-mêmes issues des politiques transversales d’insertion. Ce dispositif préconise « l’accompagnement individualisé des parcours d’insertion » : i.e qu’il prévoit de traiter les problèmes liés à la (non)concrétisation des parcours d’insertion juvéniles, dans le cadre d’une relation soutenue et renforcée entre un conseiller et un jeune. L’objet de cette communication est de proposer une interprétation des relations entre dispositifs (Deleuze, 1989) et institutions dont ce terrain parait exemplaire.
Cheminement et posture épistémologique
La question des prolongements-tensions entre institutions et dispositifs est, à l’origine, au cœur de ma recherche doctorale (2005). Partant des analyses de Jacques Ion relatives au double processus de territorialisation (Ion, 1990) et de singularisation (Ion, 1998) de l’intervention sociale, je me suis intéressée à l’émergence de « dispositifs d’accompagnement » dont le contenu et les pratiques qu’ils recouvrent paraissent difficilement modélisables lorsqu’on s’en tient uniquement à une réflexion sur les métiers du social (Barbe, 2003). Autant, sinon plus, que le savoir-faire, les formations, les métiers, le contexte d’action est déterminant des pratiques professionnelles. Ici, c’est le contexte des dispositifs qui apparaît premier dans la reconfiguration de la relation d’aide et l’instauration d’une relation dite d’ « accompagnement » pour traiter des problèmes relevant aussi bien de l’éducation des enfants que de l’insertion des jeunes. Ma démarche, visant à ouvrir la « boîte noire » des dispositifs d’accompagnement, a consisté en une enquête de type ethnographique conduite par observation. Sans partir d’une définition donnée apriori des pratiques d’accompagnement, j’ai mobilisé les outils de la sociologie interactionniste et pragmatique pour comprendre et décrire « l’ordre endogène » (Quéré, 1987) de ces dispositifs.
Le dispositif comme recomposition de l’action institutionnelle.
Les dispositifs d’accompagnement des parcours d’insertion juvénile (Trace ou Civis) sont des dispositifs au sein de dispositifs : ils prennent forme au cœur d’une première génération de dispositifs, les MLJ, créées à partir des années quatre-vingt pour faire face au développement d’un chômage juvénile de masse. L’action institutionnelle se compose ici d’un « empilement d’ordres anciens et d’ordres nouveaux » (Payet, Laforgue, 2008). Ces dispositifs de seconde génération naissent dans les failles des premiers : les carrières de l’insertion donnent lieu à des situations sociales sans qualités dont les épreuves inédites déroutent l’usager. Dans ce contexte, professionnels et usagers sont sollicités pour trouver dans le cadre d’une relation dite d’accompagnement, les ressources pour agir et s’orienter dans l’espace hostile des procédures d’insertion.
-La relation d’accompagnement constitue la pierre angulaire de ces dispositifs : le face-à-face est pensé comme le lieu pertinent de prise en compte et de traitement de situations problématiques.
-Mais cette relation d’accompagnement n’est pas régulée institutionnellement : professionnels et usagers se règlent sur la base d’accords élaborés dans un rapport de gré à gré qui font figure de pactes (Giuliani, 2008).
-L’action du dispositif d’accompagnement est régulée a posteriori par des procédures dites d’évaluation qui se focalisent uniquement sur les entrées et sorties du dispositif (les flux d’usagers). Telle que pratiquée, l’évaluation accroit le fossé entre les professionnels du front, chargés d’être « au contact » des populations dans le cadre du dispositif et les professionnels du social de gestion (Chauvière, 2007 )
Gilles Monceau (EMA, université de Cergy-Pontoise) : Construire des dispositifs socio-cliniques pour analyser des processus institutionnels
L’histoire de l’Analyse institutionnelle agence dispositifs et institutions depuis les débuts de la « psychothérapie collective » devenue « institutionnelle » dans les années 1950.
Les dispositifs y étaient d’abord thérapeutiques (en psychothérapie) et éducatifs (en pédagogie) avant de devenir plus strictement analytiques (socianalyse). Ainsi, les expérimentations et publications de F. Tosquelles, L. Bonnafé, et Jean Oury ont inspiré et croisé celles de F. Oury, R. Fonvielle et M . Lobrot mais aussi de G. Lapassade et R. Lourau. C'est en continuité avec cette histoire que ces deux derniers ont posé les bases de l’intervention socio-analytique à la fin des années 1960. La finalité analytique a alors pris résolument le pas sur les objectifs thérapeutiques et éducatifs.
Dans cette mouvance théorique et méthodologique, les dispositifs sont construits pour analyser et transformer (à des échelles très variables) les institutions. Ils sont définis comme des "structures-actions" (Lourau) agençant temps et espace en combinant stabilité et dynamique. C'est le cas du Conseil en pédagogie institutionnelle comme de l'Assemblée générale socianalytique. Des connaissances sont collectivement produites et transforment la situation sociale vécue par les sujets.
Le dispositif s'insère donc plus ou moins durablement au sein d'une entité sociale dans laquelle il permet l'analyse des phénomènes institutionnels. Aujourd'hui, les dispositifs socio-cliniques mis en œuvre dans les recherches menées sur les pratiques de la parentalité donnent, par exemple, accès à la manière dont l'action publique transforme le rapport entre parents et institutions.
- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF